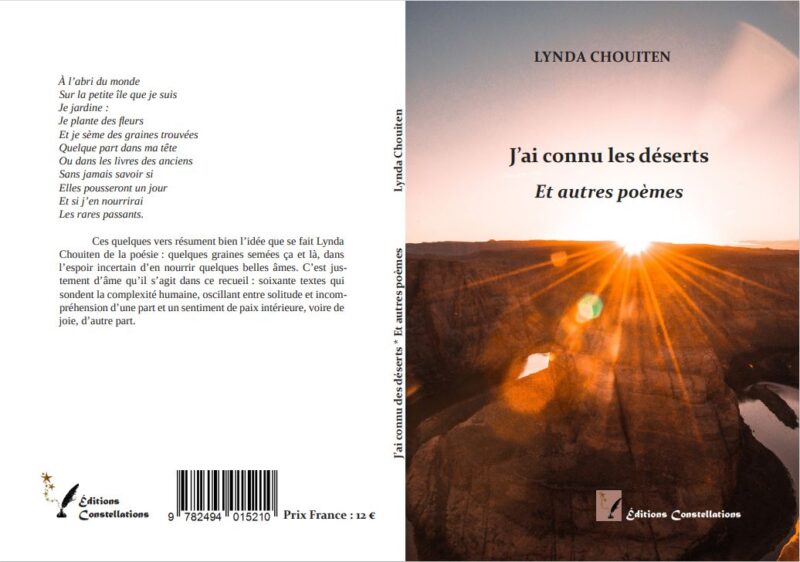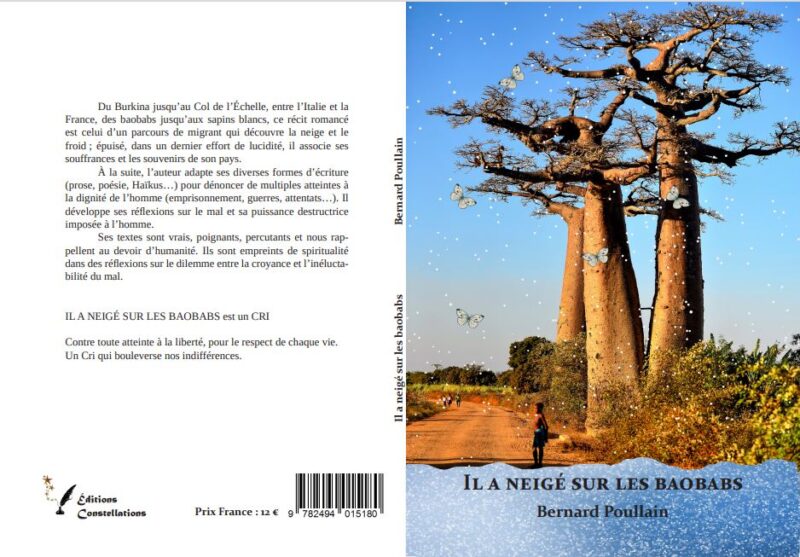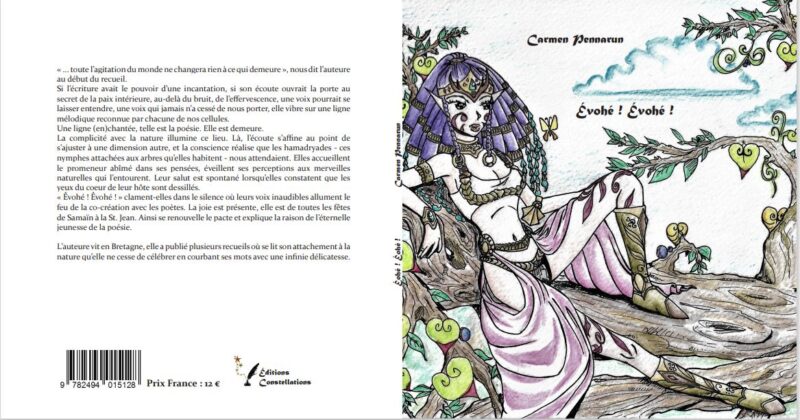
Une poésie à la fois profonde et fraîche, des mots « bulles-vert chlorophylle », des « arpèges sensitifs » qui font entrer le lecteur en résonance avec la nature, voici l’univers dans lequel on pénètre en lisant Évohé ! Évohé !, de Carmen Pennarun. Très proche du monde végétal, de la forêt et de « ses gardiens » qui « élèvent de jeunes pousses loin de la sauvagerie humaine », l’auteure se sent portée par une forme de « solidarité sylvestre ». Ainsi considère-t-elle les arbres comme des « témoins silencieux qui filtrent le défilé de la vie », et auxquels elle accorde « la confiance qu’on ne doit qu’aux grands maîtres ».
Et c’est sur les sentiers de la sagesse que la poète avance, partageant généreusement ses mots vecteurs de sérénité, d’acceptation : « Regarde tomber les fruits que tu n’as pas choisis, accepte tout sans rien trier ».
Elle sait que la patience est indispensable à celui ou celle qui est en quête d’apaisement : « Hier – une paix s’annonçait que demain attend toujours ».
Elle esquisse une temporalité nouvelle qui va « à contre-courant de l’agitation du monde » : « Laissons battre le non faire au rythme de rocaille de l’écho ».
Chez Carmen Pennarun, le silence est catalyseur d’inspiration poétique, en cela qu’il invite au recueillement en refoulant l’esprit « dans une grotte que même la salamandre dédaigne », ressuscitant les « pensées naufragées ». Il y a là une très belle allégorie poétique maritime qui se déroule lorsque l’auteure déploie la « grand’voile / sa toile de chair, sa vie », « faisant la planche », « arrimant » ses « mots et quelques peines », en attendant de trouver « un mirage – une statue de sel – en haut de la dune / au bout de sa langue de sable / où l’ange se serait endormi ».
La nature la protège dans ce périple, elle est sa confidente, son refuge, mais la descente est néanmoins « cruelle jusqu’à la mer et ses merveilles ». Celui ou celle qui rêve de découvrir « l’anse émeraude où dansent les fleurs-bateaux » devra le mériter.
Ce recueil est un joyau qui célèbre la valeur de l’Être et appelle à son épanouissement, à « l’éveil de toutes ses fibres », à la reconstruction psychique après des épreuves douloureuses : « Un poème s’est écrit sur les ruines de Noël ». Et pour guérir les âmes blessées, Carmen Pennarun fait appel au conte, à l’onirisme – « une fillette jaillit de la page » –, elle déploie, dans une étonnante respiration, ses « poèmes-marguerites dont la vie ne tient qu’à quelques troncs », offrant au lecteur une délicieuse sensation de bien-être, et inscrivant dans la mémoire du temps, ces « heures lentes où la beauté s’accomplit ».
Et c’est bien volontiers que nous partirons avec elle, demain encore, comme sa poésie nous y invite, « à la neige montante », « au hasard des métaphores », pour lancer « à la face des dieux » des « boules de rêves ».
Parme Ceriset
Carmen Pennarun vit en Bretagne et elle est membre de l’Association des Ecrivains de Bretagne. Elle a publié plusieurs recueils de poésie, dont : Nuit celte, land mer (éditions Stellamaris) ; Dans l’arc d’un regard de caryatide (éditions L’Amuse-loutre). Elle a également publié un recueil de nouvelles, et des textes dans de nombreuses revues de poésie.