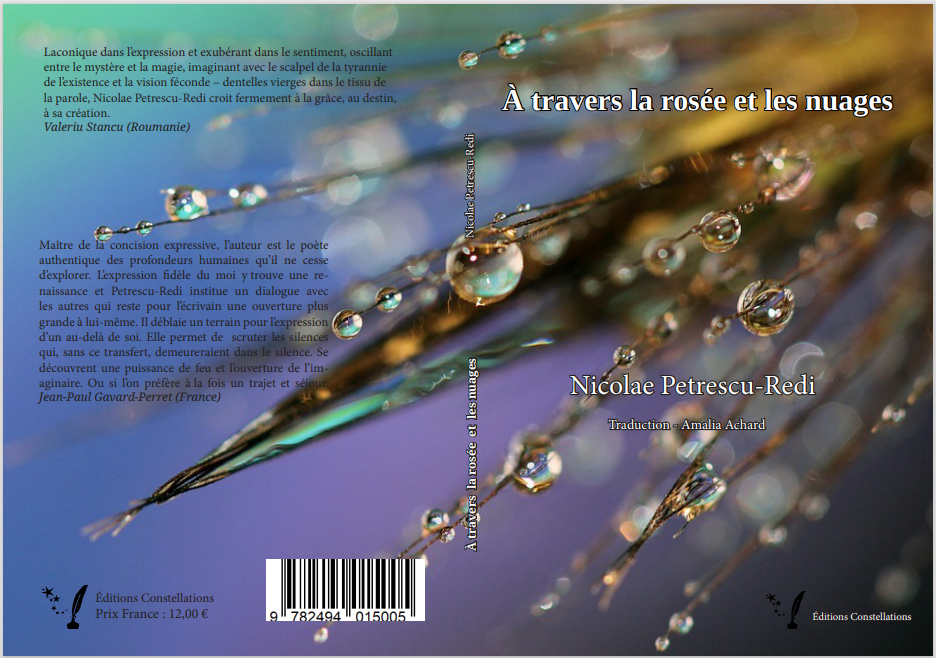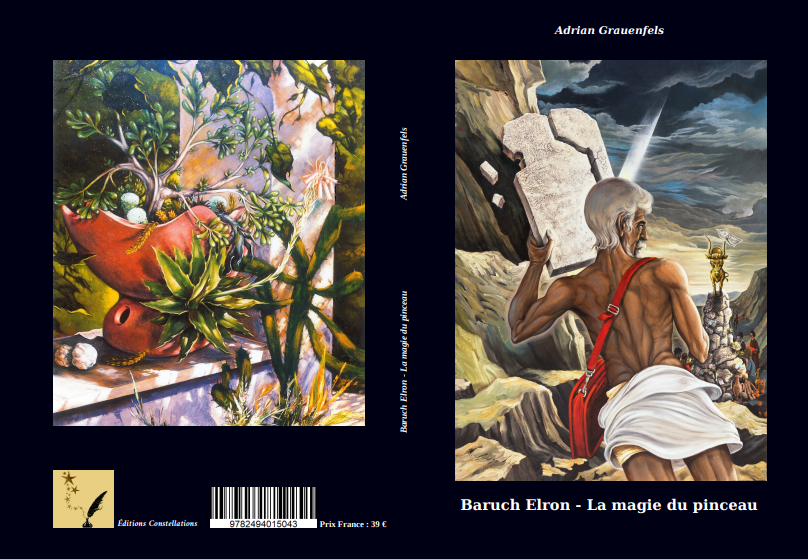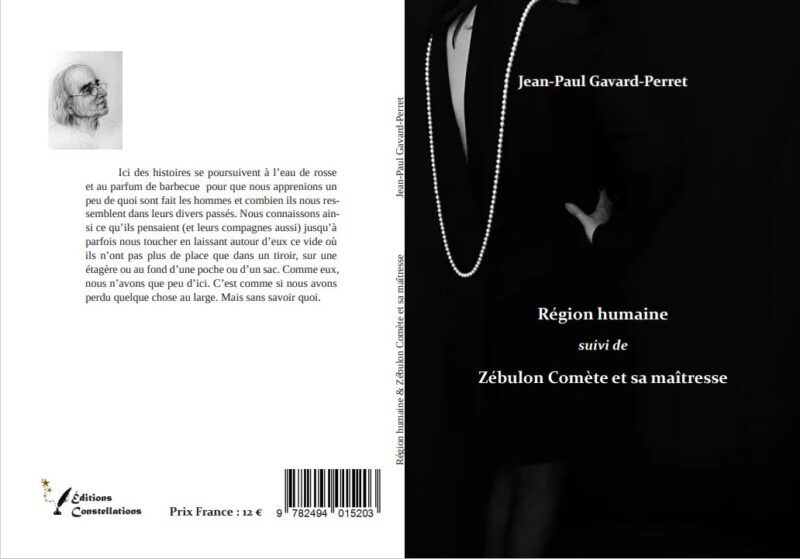Chronique de Youcef Merahi
La poésie, cette quête de l’ineffable, n’arrête pas de rebondir au moment précis où l’on se dit, elle n’a plus sa place dans l’expression humaine. Elle est décriée, ostracisée, abandonnée, mise au rebut de la lecture, mise au ban du Beau et rendue obsolète par une pensée réduite à la seule consommation, sans projection du verbe. Pourtant, elle tient tête aux vents contraires, s’accroche de toute sa vaillance, dément les avis les plus défavorables et diffère sa finitude à plus tard. Elle est là, têtue et téméraire, à dire sa (dé)raison, pour permettre aux utilisateurs de quêter la quintessence du mot dans l’infini du dire.
Lynda Chouiten m’a offert gentiment sa dernière production ; il s’agit en l’occurrence de poésie. Elle a pris le temps nécessaire à la création poétique, malgré le fait (encore une fois) que ce mode d’expression ne fait pas recette. J’ai été doublement content ; d’abord parce qu’il s’agit justement de poésie, ensuite parce qu’il faut du courage pour tenter l’édition, sachant que cette dernière n’a pas les faveurs du lectorat. Je me suis laissé guider par elle dans les dédales de ses cris, de ses espoirs, de ses rêves, de ses révoltes (c’est souvent le cas), de ses volontés à s’affranchir de toutes sortes d’écueils. J’en suis revenu la tête pleine d’images et de sollicitations à m’arrêter derrière chaque poème. Rien que pour cela, je dis merci à Lynda Chouiten de m’avoir permis de passer le seuil de ses attentes existentielles.
Lynda Chouiten a déjà goûté à la fièvre de l’édition avec coup sur coup deux romans, qui ont pris d’autorité leur place parmi les lecteurs ; Le roman des pôvres cheveux, éd. El Kalima et La valse , éd. Casbah, ont montré une auteure maîtrisant le style romanesque, montrant des capacités à construire un scénario (un roman) et proposant une thématique nouvelle. Après son recueil de nouvelles, éd. Casbah, Des rêves à leur portée, Chouiten – une touche-à-tout — montre son penchant pour la poésie, se révèle être en mesure de soutenir le rythme et le souffle du poème avec talent, et propose également d’esquisser une ouverture timide dans son monde intérieur ; car elle a encore beaucoup de choses à (nous) dire. J’ai connu les déserts et autres poèmes, éd. Constellations, 2023, est un recueil de poésie écrite avec beaucoup de douceur et de spontanéité, sans aller jusqu’à l’agitation inutile qui étreint parfois le poète ; s’agissant d’une écriture féminine, il est loisible que Chouiten pouvait être tentée de régler des comptes avec une société, qui n’arrive pas encore à être impartiale ; comme elle s’estime en phase avec elle-même, c’est-à-dire un partenaire pouvant (se) prendre en charge ses émotions d’abord, ensuite, ses rêves et autres ambitions. Laissons dire Lynda Chouiten : «Alors je me hâte de cacher la clé / Là où je ne peux pas la retrouver / Tout en me convainquant que ma tour est bien faite d’ivoire/Que ses murs ne sont pas fissurés / Qu’elle ne sent pas le moisi / Que ses chauves-souris ne m’effraient pas / Et que je me plais dans sa majesté désuète.» (p.43)
Ce que j’ai remarqué en premier chez Lynda Chouiten, c’est d’abord cette assurance mesurée de maîtriser son sujet poétique, de croire en son destin de celle qui a le don de proposer tout un monde à découvrir, et, surtout, de ne jamais douter de cette force intérieure, qui permet au poète de (dé)montrer à tous qu’elle est encore utile, présente et affirmant ses propos. Il y a une certaine aisance à monter, fignoler, peser le poème et l’offrir, d’abord, au silence de la page brouillon, ensuite, au regard de soi, puis de celui d’autrui. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais, j’ai ressenti une assurance tranquille, lors de ma lecture de cette somme de poésie, affichée par le poète le long de son écriture. Le poème coule de source. À croire qu’il n’y a aucune anicroche qui vient perturber le poème. Je crois que c’est là la force de Lynda Chouiten, cette aisance à maîtriser le verbe, sans tourment quelconque, tout le temps qu’elle se trouve face à la page blanche. N’y a-t-il pas ce vertige qui touche les poètes, chez elle ? Justement, non ; elle maîtrise de bout en bout son sujet. Le seul code dont elle use, dans J’ai connu les déserts et autres poèmes, reste précisément cette facilité dans le vocabulaire, la conception du texte et sa clarté. Laissons dire Lynda Chouiten : «Un jour j’irai en Islande / Et loin de toi, mon pays / J’oublierai la chaleur / De ton soleil et de tes gens / Et me demanderai si c’est son intensité / Qui fait tout pourrir, même les cœurs les plus purs / Et tout fondre, même le fer de notre détermination / Puis l’accueil froid des glaciers / Me fera sourire, et j’y penserai plus / Je marcherai, grelottante et éblouie / Dans ses déserts silencieux / Si différent du nôtre / Je courrai vers les volcans, trop longtemps contenue / À la leur / Et quand naîtront les geysers / J’y reconnaîtrai mes frères / Et je les imiterai / Alors dans la lourdeur blanche de l’hiver / Je me sentirai moins seule / Et plus légère encore.» (p. 77)
Le désert dans la poésie de Lynda Chouiten n’est pas matériel, ni intellectuel ; il se situe plutôt dans une sensation désagréable de se sentir «désertique» de l’intérieur ; est-il ressenti d’une certaine solitude surpeuplée ? Ou est-ce une certaine faim assumée d’aller vers l’Autre, sans recevoir en contrepartie la reconnaissance attendue ? À moins que l’auteure, ici, veut tout simplement bâtir un rempart poétique entre elle (l’intime) et l’extérieur («l’extime»). Il y a naturellement cette propension à tenter le poème pour exorciser cette «chose» que Lynda Chouiten ne nomme pas, comme «ces cailloux» (Eluard) qui pèsent sur le ventre. Il est vrai qu’elle n’est qu’à ses débuts. Je reste tout de même sûr, l’auteure saura plus tard proposer une palette de voies, à même de tenter une esquisse de lecture de sa poésie. Il y a, c’est vrai, un peu le mal de vivre dans ses poèmes ; mais, il y a également cette attitude résolue d’affronter toute adversité. Je comprends son assurance, quand bien même elle intitule son recueil, J’ai connu les déserts, et autres poèmes. Une fois le désert défini, selon l’orientation voulue par Lynda Chouiten, je crois qu’il serait possible, dès lors, d’aller à la rencontre de sa poésie sereinement. Et c’est ainsi qu’on pourra saisir quelques fêlures, des cris sans violence, une protestation avenante et une main tendue, large comme son espoir.
La fluidité dans les poèmes de Lynda Chouiten rend la lecture de ce recueil très agréable. Je crois pouvoir dire que c’est là une force principale dans l’écriture de cette auteure, avec bien sûr, sa maîtrise de la langue et sa manière de poser la thématique choisie. Après deux romans et un recueil de nouvelles, fortement appréciés, Chouiten propose une autre facette de son art, la poésie. C’est ce qui fait sa force et ce qui peut lui faciliter, plus tard, la proposition d’une œuvre ; celle-ci, à l’image des prédécesseurs, pourra (doit) être une voie singulière dans la littérature algérienne. Je laisse Lynda Chouiten clore cet espace de parole : «De quelle douleur me parlez-vous ? / De celle de devenir étrangère / Sur cette terre qui m’a vu naître / Après avoir vu naître mes parents / Et leurs parents ? / De celle de rêver en regardant/ Les oiseaux et les bateaux / En repensant à Joyce / Qui a quitté l’Irlande / Sans qu’elle ne le quitte jamais / Et au mythe d’Icare / Qui a fui le Minotaure / Et son triste labyrinthe / Et dont le rêve fou/D’étreindre le soleil / L’a fait, à tout jamais / Prisonnier des vagues.»(p.83)
Youcef Merahi